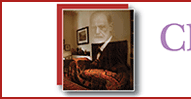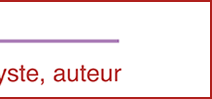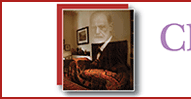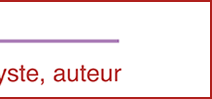| |
une rencontre sans “ formation de compromis ”
Sans émotion, il n’y a pas de créativité. Sans engagement, il n’y a pas d’actualité. Sans implication, il n’y a pas d’opinion. Sans désir, il n’y a pas de vocation. Sans évaluation, il n’y a pas de discernement. Sans discours, il n’y a pas de dialogue. Sans revendication, il n’y a pas de principes…
… Patrick Poivre d’Arvor fait l’événement car s’il revendique, c’est qu’il a des principes, s’il “ discourt ” c’est qu’il aime le dialogue, s’il évalue c’est qu’il discerne, s’il désire c’est qu’il assume sa vocation, s’il s’implique c’est qu’il se forge une opinion, s’il s’engage c’est qu’il fait l’actualité, s’il émeut c’est qu’il crée…
… Finalement, Patrick Poivre d’Arvor ne fait pas l’événement, il est plus juste de dire qu’il le crée dans le sens où il agrandit l’univers du téléspectateur, observateur protégé, qui peut alors animer le contenu de l’information, un peu à la façon de Diderot pour qui le spectateur devient l’acteur. L’impression est la même lorsqu’on interviewe Monsieur d’Arvor car il a l’art et la manière, mais essentiellement l’humilité, de mettre la balle dans le camp de l’interlocuteur. D’ailleurs, Patrick Poivre d’Arvor ne fait pas attendre, il reçoit à l’heure, il veut aimablement donner l’illusion d’avoir du temps, comme s’il nous accordait la priorité. Difficile dans ces conditions de ne pas tomber sous le charme… Du reste se livre-t-il en toute simplicité…
Patrick Poivre d’Arvor : C’est bien, je vois que vous avez pris un second magnétophone par sécurité.
Psychanalyse Magazine : Oui, parce que nous avons déjà eu des problèmes !
PPDA : Ça, c’est une réaction de professionnel !
P. M. : Ou d’angoissé !
PPDA : Non, non. Moi, un jour, ça m’est arrivé. Pour Le Journal du dimanche, j’interviewais le Premier Ministre de l’époque, Pierre Mauroy, et mon magnétophone n’avait en fait pas fonctionné. Heureusement que j’avais pris des notes mais pour tout recomposer de mémoire, je peux vous dire que ce n’était pas évident parce que l’on a peur de ne pas retranscrire les propos avec exactitude.
P. M. : C’est justement aussi pour ne pas déformer vos propos que nous aimerions que vous vous présentiez.
PPDA : Né à Reims il y a 51 ans, d’origine bretonne et auvergnate mais essentiellement d’origine bretonne, j’ai fait des études dans ma ville natale jusqu’à mon bac que j’ai eu assez jeune. Ensuite, j’ai passé un an à Strasbourg où j’ai fait du droit et Science Po. Je suis ensuite “ monté ” à Paris, comme on dit, où j’ai continué droit – Sciences Po. J’ai ajouté à cela des langues orientales : russe et serbo-croate, puis une école journalistique, le CFJ. Par ailleurs, j’ai gagné un concours qui était organisé par France Inter : “ Envoyé Spécial ”, dont le but consistait à faire le tour du monde pendant un an et d’engager ferme à France Inter la personne qui gagnerait le concours. C’est ce qui m’est arrivé fin 1971 et pendant trois ans et demi, j’ai travaillé à la radio. Je suis entré sur la 2 le jour de la création d’Antenne 2 en janvier 1975 ; assez vite, j’ai présenté le Journal et cela durant sept ans. Ensuite, j’ai eu quelques petits problèmes parajournalistiques, plutôt d’ordre politique et j’ai quitté cette chaîne. J’ai, dès lors, beaucoup écrit, publié des livres, fait le tour du monde en train, travaillé pour la presse écrite, notamment Le Journal du dimanche et Paris Match, fait des chroniques radio et collaboré au lancement de Canal +. Et lorsqu’en 1987 est arrivée la privatisation de TF1, j’étais à TF1 où j’animais une émission de l’après-midi. J’ai eu alors à choisir entre diverses propositions qui m’ont été faites sur la Une, la 2 et la Cinq ; j’ai choisi de rester sur la Une et de présenter le Journal, ce que je fais depuis onze ans. S’ajoute à cela le dixième anniversaire de l’émission “ Ex-libris ”…
P. M. : Enfant, aviez-vous l’impression que quelque chose d’ambitieux se passerait lorsque vous seriez adulte ou pas du tout ?
PPDA : Si vous parlez du petit garçon, ce n’est sûrement pas par hasard, l’inconscient le sait. En effet, j’aime toujours raccorder ce que je suis à ce que j’étais d’une part et à ce que je voulais être surtout. Je pense que je n’étais pas doté des meilleurs atouts, d’abord parce que je suis issu d’un milieu familial qui n’avait pas de relations, donc il n’y avait aucune espèce de raison pour que je sois favorisé par le sort. Ensuite, Reims ce n’est pas Paris avec toute la difficulté que cela implique pour sortir de sa glaise. Troisièmement, j’étais terriblement timide, très très sauvage. Je me réfugiais beaucoup dans la compagnie des livres et j’avais une vision assez absolue de la vie, une approche livresque du monde. Je formulais plutôt des rêves de gloire à la Napoléon, Alexandre, Stendhal, donc pas de rêves de paillettes, pas de cinéma, ni de télévision. Et puis, à l’époque, la télévision n’existait pas ; de fait, je n’avais pas le désir d’être connu pour être connu. J’avais le désir de “ faits d’armes ” comme pour éprouver mon courage, ma timidité. Finalement, j’avais envie de ne pas être quelqu’un comme les autres parce que je savais déjà que j’étais singulier. Je me sentais tellement seul par rapport à mes petits camarades ; je voyais bien que j’étais différent ; j’en souffrais et comme toujours, à un moment donné, on fait d’un mal un bien. De la même manière, lorsque je me suis rendu compte que je n’arrivais pas à dormir la nuit, j’ai transformé mes insomnies en lectures, en écritures assidues. C’est formidable, cela m’a permis de réaliser une bonne transformation de ce que je vivais mal.
P. M. : Ce processus de sublimation n’est pas donné à tout le monde, d’instinct…
PPDA : C’est-à-dire qu’il faut toujours faire la part entre l’orgueil qui consiste à vouloir vraiment devenir quelqu’un, je dirais presque par envie, et puis ce que l’on a en soi qui est simplement le désir, semblable à une corde qui serait tendue comme celle d’un arc et capable d’emmener votre flèche très loin. Pourquoi une corde est-elle particulièrement tendue ? C’est toujours difficile à dire. Parfois, l’enfance a été trop douloureuse, d’autres fois, c’est parce qu’elle a été très heureuse. Beaucoup d’éléments font qu’il y a un moment donné où l’être humain explose et où plus rien ne l’arrête ; étranges sont les ressorts non seulement du succès, mais du désir. En général, j’ai plutôt remarqué que lorsque c’est dur, lorsqu’il y a eu des obstacles à surmonter, on est plus fort globalement. Lorsque j’étais jeune, j’ai été malade et je pense que la maladie peut aider. J’ai souvent constaté que les enfants malades sont ceux qui s’en sortent le mieux ; ils sont plus solides après, même sur le plan de la santé.
P. M. : N’y a-t-il pas une jouissance à érotiser la douleur ?
PPDA : C’est possible, en tout cas à la regarder, à tourner autour, à la considérer et à ne pas la nier. Pour ma part, je fonctionne beaucoup à l’instinct, donc je conceptualise peu.
P. M. : Peut-on faire de la douleur son alliée ?
PPDA : Oui, tout à fait. C’est ce que l’on vous raconte à l’adolescence ; on vous dit facilement que c’est l’épreuve qui fabrique l’Homme mais on n’y croit pas ; on pense que ce sont des histoires, du rêve. Lorsque vous venez de perdre quelqu’un, on vous affirme que vous allez voir comme vous allez être plus fort. Tout d’abord vous avez envie de répondre que vous auriez préféré ne pas le perdre. Ce qui est la moindre des évidences, mais en fait la vérité est qu’en effet on est plus fort après. Moi, je m’en suis rendu compte notamment après la perte de Solenn qui a été l’événement majeur de ma vie. J’étais à deux doigts de “ dévisser ”, de glisser au fond d’un gouffre et je pense que j’ai pu sublimer cet état grâce à l’écriture. Il faut toujours, je crois, dire les choses ; c’est capital : que ce soit dans le cabinet d’un psy, dans le secret d’une conversation particulière avec un ami, avec une personne qui vous est chère, ou bien encore à travers un livre, une expression publique quelconque. Puis, il y a le sentiment que l’on est protégé par les choses qui nous sont déjà arrivées et qui ont été tellement affreuses que tout le reste s’en trouve étalonné. C’est la comparaison de ce qui est important avec ce qui est accessoire. Dans mon milieu, on me sort souvent des broutilles de ci, de là, tel jour, telle semaine, tel mois, mais tout cela n’a vraiment, à mes yeux, que très peu d’importance. Je crois avoir vu ce qui était important : le pic absolu de la douleur notamment. Donc, à cet égard, oui, on peut faire de la souffrance une amie.
P. M. : Selon vous, la souffrance a donc quand même un sens ?
PPDA : Je ne sais pas si c’est un sens mais je comparerais plutôt ce mécanisme à ce que font les judokas, c’est-à-dire qu’à l’instant où il ne vous reste plus qu’un pouce du pied sur le tatami, vous allez pouvoir transformer tout cela en énergie suffisamment positive afin de retourner la situation. Voilà, donc, ce n’est pas un sens, c’est un outil peut-être.
P. M. : Vous avez fait allusion à la psychanalyse. Dans “ Lettre à l’absente ”, on a l’impression que vous avez une approche un peu tiède du psychanalyste…
PPDA : Je n’ai pas une approche “ tiède ” du psychanalyste mais peut-être de la psychanalyse. J’ai rencontré des psychanalystes formidables, vraiment formidables…
P. M. : Donc, ça existe ?
PPDA : Bien sûr ! Des gens de très haute qualité, notamment la personne qui s’est occupée de Solenn sur la fin de sa vie et qui est une femme d’une immense qualité. Mais j’ai lu aussi des ouvrages abscons qui vous dégoûtent de la psychanalyse à tout jamais alors que par nature, moi, c’est un sujet qui me passionne. Lorsque j’étais jeune, j’ai été passionné tout d’abord par la philo, puis par la psycho et tout ce qui touchait à ces domaines. J’avais alors une véritable approche positive mais, après, je me suis rendu compte qu’il y avait des querelles de chapelles, ces espèces de combats, de débats d’idées qui ne servaient pas du tout la psychanalyse. On peut même avoir l’impression de sectes qui se referment sur elles-même constituant une sorte d’élite qui s’adresse aux élites et je trouve ces attitudes mauvaises parce que la psychanalyse est très intéressante. J’ai entendu des gens m’expliquer calmement, de façon limpide, des situations embrouillées et uniquement avec le ressort de l’analyse. Bien sûr, comme dans toute profession, il y a de tout. C’est exactement le cas de mon métier : il y a des journalistes agressifs, envieux, et des journalistes généreux, ouverts, cultivés. Simplement, il me semble que nous, nous avons davantage le désir de faire connaître le monde et j’ai eu quelquefois le sentiment que la psychanalyse n’avait pas toujours eu cette envie de se faire connaître suffisamment et qu’en fait, les psychanalystes étaient ravis d’être entre eux.
P. M. : C’est pour les raisons que vous évoquez que nous avons créé ce Journal qui existe afin de transmettre.
PPDA : Effectivement, c’est pour cela que votre démarche, au travers de ce que vous m’en avez dit, est très bonne.
P. M. : D’autant que la psychanalyse est une jeune fille… et demeure méconnue quant à son apport.
PPDA : Bien sûr, elle n’a qu’un siècle, elle a encore le temps d’évoluer mais les tentatives de reprise sont souvent délicates comme dans toute activité, dans toute société. Il faut s’ouvrir davantage.
P. M. : Le mot ouverture est-il important pour vous ?
PPDA : Primordial, c’est l’ouverture qui empêche le racisme, qui offre la culture, la tolérance. C’est l’ouverture qui permet la découverte de l’autre, donc peut-être l’amour. Les gens qui, par nature, mettent un double vitrage avant de sortir dans la rue ne seront, en effet, pas agressés par une quelconque pollution ou par un virus extérieur mais ils ne seront pas davantage non plus touchés par un coup de foudre, une émotion ; or il faut évidemment être ouvert à tout. C’est tout de même l’un des plus beaux avantages de la vie que tout puisse arriver à chaque instant ; on se lève le matin et on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Ceux qui pensent qu’ils le savent déjà sont des gens qui ont des vies subies, qui font des métiers parfois pénibles qu’ils n’aiment pas et je pense que c’est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain. La pire des choses, c’est d’abord de ne pas avoir de métier et la deuxième, c’est de faire un métier contraint et forcé. Dans la mesure du possible, on doit exulter dans son métier, à la limite il faudrait presque payer pour le faire. De temps en temps, ce sont des réflexions que nous faisons entre journalistes ; on se dit : c’est tellement merveilleux ce qui est en train de nous arriver à cette seconde “ s ”.
P. M. : Contrairement à la psychanalyse où ce sont les patients qui viennent à elle sans y être obligés, n’avez-vous pas un peu l’impression d’agresser et de contrôler finalement les auditeurs puisque c’est “ votre ” information, telle que vous pouvez la percevoir au travers justement d’affects que vous véhiculez ?
PPDA : Tout d’abord, je considère et j’ai toujours dit que l’on est dans un métier totalement subjectif. Il est tout à fait absurde de prétendre que nous sommes objectifs envers quoi que ce soit. Tout ce que je vous ai relaté sur mon parcours affecte, colore évidemment mes émotions et mes réflexions sur l’actualité. Il s’agit-là de l’influence du passé d’un homme mais aussi la possibilité au travers de cela pour cet homme d’être justement suffisamment ouvert pour beaucoup écouter ce qui se passe autour de lui. Et autour de lui, qu’est-ce que c’est ? C’est une rédaction, ce sont des gens également liés, de chair et de sang, qui sont pour, qui sont contre, qui ont des opinions. Il est très important d’être attentif à tout le monde puis après de dégager sa synthèse personnelle. Voilà pour une première chose mais, en même temps, je reconnais que c’est notre choix dans ce qui nous paraît important et, qu’après tout, peut-être que le téléspectateur lui-même aura un avis différent : cependant, on lui offre un choix, en ce sens qu’on lui offre la possibilité de penser ce qu’il veut, ce qui n’est pas toujours le cas, il est vrai, chez un certain nombre de journalistes qui peuvent avoir ce côté très “ pensé ” où l’on va prédigérer votre réflexion ; ils vont vous coller un éditorial, vous imposer un point de vue. Je pense qu’il faut donner tous les éléments d’une actualité pour que le public se fasse sa propre opinion. Je n’aime pas cet aspect un peu “ souligné ” au crayon rouge de certains organes de presse. Vous avez donc raison, mais je ne dirais pas que c’est une agression. C’est plutôt une proposition que l’on fait aux téléspectateurs et ensuite ils peuvent choisir, tout comme ils peuvent choisir aussi de ne pas nous regarder du tout ; ils ont la chance d’avoir aujourd’hui une centaine de chaînes. Hier, ils ont été 41 ou 42 % à l’écoute mais ils pouvaient tout aussi bien être sur la 2, la 3, la 4, la Cinq, la 6, toutes les chaînes câblées, les chaînes satellites, etc. C’est déjà important d’avoir le libre choix, de consulter ou pas le psy et de choisir le psy que l’on veut et de la même manière, de regarder ou de ne pas regarder la télévision et de pouvoir choisir la chaîne ; ce libre-arbitre est important.
P. M. : Constatez-vous, puisque vous avez des années d’expérience professionnelle, une évolution du profil du téléspectateur ?
PPDA : Je pense qu’il ne faut jamais parler du public parce que le public, par définition, ça n’existe pas. Il semble mieux approprié, comme vous le dites, de parler de téléspectateurs. Ceux du début et puis des gens tellement différents qui nous regardent aujourd’hui avec des niveaux de culture, de vécu qui n’ont aucun rapport. Donc oui, les gens évoluent ; on le voit bien quand ils passent de la solidarité au repli, de l’individualisme à un peu plus de collectif à nouveau. Ce sont des faits très difficiles à analyser et il y a des instituts spécialisés pour cela mais, cependant, j’en reviens à dire qu’il faut beaucoup parler, dialoguer avec les gens. Je reçois environ deux cents lettres par jour de tous horizons et je suis très intéressé par leur lecture : il faut que je sache. Alors, évidemment, il y a ceux qui critiquent. Il n’y a que les lettres anonymes que je ne lis pas parce que quelqu’un qui n’a pas le courage de signer n’est pas bien intéressant : ce n’est plus un dialogue, mais en revanche, tout attire mon attention et parfois j’en tiens compte.
P. M. : Vous dites “ parfois ” ?
PPDA : Oui, parce que sinon, à ce moment-là, ce serait une forme de dictature de l’opinion et je deviendrais comme un homme politique ne disant que ce qui plaît aux gens ou ce qui est supposé aller dans le sens du poil. Heureusement, un journaliste a quand même lui aussi son libre-arbitre et quand je dis “ parfois ”, je signifie que j’en tiens compte, c’est-à-dire que quelquefois je constate que l’on a commis des fautes de goût par exemple, alors je corrige la fois suivante. J’écoute tout le monde, même les opinions qui sont tout à fait contraires aux miennes et cela pour colorer mon jugé.
P. M. : Malgré tout, vous gardez une position de maîtrise, ce qui est logique.
PPDA : Oui, d’abord c’est normal parce que, à un moment donné, il faut bien qu’il y ait quelqu’un qui choisisse et puis dans ce métier où l’on fait appel tout particulièrement aux nerfs, au sang-froid, il est indispensable qu’à un certain degré la décision vienne de vous. Peu importe de quoi elle a été précédée, si c’est une maturation, d’allers et retours ou d’imprégnations diverses.
P. M. : Peut-on parler d’une certaine forme de provocation dans votre métier ?
PPDA : On ne provoque pas tellement, en tout cas pas au Journal Télévisé, à la télévision peut-être parfois à certains moments, mais le Journal demeure tout de même quelque chose d’assez institutionnel. Certains appelle cela la “ grand-messe ”. On n’imagine pas un bon docteur arrivant pas rasé, sans cravate et accroupi sur le bureau ; il y a là une espèce de rhétorique, de gestuelle qui s’impose. Le Journal Télévisé n’est donc pas le vecteur premier de la provocation.
P. M. : Mais, au niveau du discours, peut-il y avoir de la provocation ?
PPDA : Oui et ça, c’est bien, c’est même important. Je ne parle pas de la provocation extrême, mais ce qui m’intéresse en revanche, c’est l’excitation, l’excitation des sens.
P. M. : Freud parlait de “ stimuler ” le patient dans la cure ; les lacaniens disent qu’ils “ hystérisent ” l’inconscient. Les attitudes professionnelles se rejoignent finalement…
PPDA : Je suis pour “ prendre les gens à contre-pied ” de temps à autre. Pas tout le temps , parce que ça deviendrait un jeu, un systématisme qui ne serait plus intéressant puisque le téléspectateur saurait. Lorsque je dis “ contre-pied ”, qu’est-ce que c’est ? C’est par exemple d’avoir décidé avec Marine Jacquemin de partir au Soudan et de faire une grande page spéciale durant treize minutes ; c’est tout d’un coup, pour le téléspectateur, voir “ leur ” présentateur au Soudan parler de la faim dans le monde à un moment où ils ne s’y attendent pas et donc provoquer une réaction. Ce peut être aussi à la suite d’un sujet comme celui de cet enfant trisomique qui est mort et d’en faire quelque chose de beau en montrant des gens qui essaient de sortir les enfants lourdement atteints. Les téléspectateurs ont alors un sujet d’étonnement : d’un fait divers, ils passent soudainement à un magazine, lequel, je dirais, va entraîner une interrogation puis une réflexion.
P. M. : Ce processus permet-il d’introduire la différence ?
PPDA : Ah oui, parce que rien n’est pire que l’uniformité. D’abord, l’uniformité entraînerait très rapidement l’ennui et les gens auraient envie d’aller voir ailleurs ; ensuite, il faut s’adapter ; il y a des séquences. Le monde évolue surtout depuis 1945, il a même bougé depuis 1989 ; il faut donc toujours être à l’écoute, regarder. Je pense qu’il est absolument nécessaire d’agir de la sorte. Encore une fois, j’insiste : être à l’écoute de tout ce qui bouge, avoir le nez en l’air, les narines qui tremblent, observer, frémir, en attente, aux aguets, à l’affût des moindres détails.
P. M. : Que diriez-vous de la solidarité ?
PPDA : La télévision dispose d’un vecteur formidable pour donner. Nous travaillons sur ce que l’on appelle “ une chaîne ”, donc pourquoi ne pas faire des chaînes, de vraies chaînes de solidarité ? Je pense que si l’on montre aux téléspectateurs que d’autres souffrent, que d’autres s’en sortent ou que d’autres positivent une situation délicate, etc., on agrège ainsi des solidarités et les gens peuvent alors se remonter le moral par eux-mêmes en se disant : mais il y a pire que moi, mais telle personne qui est dans ma situation s’en sort, donc je peux moi aussi m’en sortir… Il y a là un vecteur exceptionnel qu’il serait criminel de ne pas utiliser pour donner des informations, pour montrer les aspects, tout de même relativement nombreux, qui témoignent des valeurs de l’âme humaine alors que l’actualité, en général, ne montre que des aspects noirs : catastrophes, trahisons, meurtres, attaques politiques, disputes en tout genre, guerres, etc.
P. M. : Avez-vous envie de conclure ?
PPDA : Non, c’est vous qui concluez. Moi, je ne suis jamais qu’un patient sur mon “ divan ” et vous qui m’interrogez !
P. M. : Y-a-t-il de l’inattendu pour vous dans cette démarche d’être interviewé par des psychanalystes ?
PPDA : Ce n’était pas inattendu mais il vrai que je refuse vingt-cinq interviews par jour parce que j’ai l’impression de ressasser toujours les mêmes questions, donc les mêmes réponses. Et là, j’ai dit oui tout de suite, spontanément. D’abord, parce que vous êtes un jeune journal et qu’il faut vous aider mais, surtout, parce que ça changeait, ça égayait mon quotidien…
Interview réalisée pour Psychanalyse Magazine en avril 1999.
|
|